- À Propos
- SINGA dans le monde
- Entrepreneuriat
- Rencontres interculturelles
- Se former et s’informer
La “Charte de Marseille” : un outil pour transformer le traitement médiatique des migrations

Adoptée ce mardi 29 avril 2025 à Marseille, lors des Assises du Journalisme et Citoyenneté, une charte sur le traitement médiatique des migrations pose 11 principes fondateurs pour repenser en profondeur la manière dont les médias abordent ces enjeux. Son ambition: faire évoluer les récits, les pratiques et les regards.
Vers une couverture plus éthique, précise et respectueuse des questions migratoires
Dans un contexte marqué à la fois par la complexité des dynamiques migratoires et par la montée des discours stigmatisants, la Charte appelle à un traitement journalistique rigoureux et nuancé.
Conçue à l’initiative de journalistes, chercheur.es, syndicats, écoles et médias, notamment GuittiNews, SNJ, Désinfox migrations, elle incite à la diversité des sources, l’écoute active des personnes concernées, et porte une attention particulière au vocabulaire utilisé. En s’appuyant sur des définitions juridiques, scientifiques et administratives, elle vise à renforcer la qualité de l’information, tout en luttant contre les stéréotypes.
La charte précise dès son préambule qu’elle « vise à soutenir les journalistes et les professionnels des médias dans leur souhait de proposer une couverture de qualité, précise, complète et éthique des questions migratoires, en intégrant notamment les recommandations issues de textes déontologiques de référence ».
Le traitement médiatique des migrations ne relève pas d’un choix éditorial, mais d’une responsabilité professionnelle et sociale. Dans le cas des migrations, cette responsabilité est d’autant plus grande que les conséquences d’un traitement médiatique non rigoureux ou stigmatisant sont immédiates : politiques répressives, violences symboliques et réelles à l’encontre des personnes nouvelles arrivantes.
Onze principes pour transformer les pratiques
Les 11 principes fondamentaux de la Charte de Marseille :
- Prendre conscience que le sujet des migrations doit être traité de manière transversale
Les causes des mobilités humaines sont complexes et multifactorielles. Les angles de traitement doivent être exigeants et refléter ces différents prismes. - Rectifier les informations fausses ou erronées sur le sujet des migrations
Tout journaliste digne de ce nom dispose d’un droit de suite, qui est aussi un devoir, sur les informations qu’il diffuse et fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révèlerait inexacte. Le travail de fact-checking est recommandé pour les déclarations publiées ou prononcées par des personnalités publiques au sujet des migrations. - Exposer les mécanismes de la désinformation et des stéréotypes sur les migrations en fournissant des informations vérifiées, sourcées, et contextualisées
Un journaliste doit respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. - Veiller à ne stigmatiser aucune population
Les journalistes doivent garantir que toute couverture médiatique respecte la dignité des personnes migrantes et s’interroger sur leurs propres perceptions et biais. La Charte de Marseille recommande aux journalistes de ne mentionner l’origine, la religion ou l’ethnie que s’ils estiment que cela est pertinent pour l’information du public. - Ne pas invisibiliser les personnes migrantes
Une couverture journalistique équilibrée des migrations doit prendre soin de s’informer auprès de l’ensemble des parties prenantes, en particulier les premiers concernés. - Être vigilant sur les termes employés
Migrant, immigré, réfugié, étranger ou demandeur d’asile n’ont pas la même signification. Les journalistes veilleront à employer les mots les plus appropriés, en se référant aux définitions juridiques et scientifiques ainsi qu’aux catégories administratives en vigueur pour éviter amalgames et approximations. - Appliquer les règles élémentaires du droit à l’image
Les journalistes prendront les précautions qui s’imposent en s’assurant du consentement explicite et éclairé des personnes migrantes lorsqu’elles seront filmées, enregistrées ou prises en photos. - Veiller à utiliser des images d’illustration qui reflètent la diversité des migrations
Les journalistes veilleront à rester exigeants quant à la pertinence des photos ou images d’illustration. Celles-ci doivent refléter le sujet traité de la manière la plus fidèle et la plus actuelle possible. Cela vaut aussi pour l’utilisation de banques d’images, d’archives ou d’intelligences artificielles génératives. - Mettre en avant les faits, les replacer dans leur contexte
Les journalistes respecteront la rigueur scientifique des chiffres et des données statistiques. Ils veilleront à les mettre en perspective, afin d’éviter le « traitement au cas par cas » et d’informer au mieux sur les causes et les effets politiques, économiques et climatiques des migrations. - Se former et former ses pairs
Les journalistes doivent avoir accès à des formations initiales et continues sur la couverture des migrations tant sur les évolutions législatives que sur les droits humains ou les travaux scientifiques les plus récents. Ces formations devraient favoriser les partages transfrontaliers (conférences académiques, séminaires, rencontres professionnelles ou reportages collaboratifs avec des rédactions étrangères). - Mesurer l’impact et perfectionner les méthodes
Les journalistes et leurs rédactions sont invités à réaliser des audits internes réguliers pour évaluer et améliorer les pratiques journalistiques en vigueur à l’aide d’outils comme des glossaires et des partages d’expérience.
Un outil à utiliser, partager, faire vivre
Plusieurs dizaines de médias sont signataires : Mediapart, Reporterre, l’Humanité, Info Migrants, Alternative Économiques, Deutsche Welle, La Marseillaise mais aussi des écoles de journalisme, des syndicats professionnels, des formateurs, des collectifs de journalistes proches de SINGA. Elle compte des signataires en France, au Sénégal, en Belgique, au Maroc.
Des évènements s’organisent à travers la France afin de diffuser cette avancée majeure dans la manière d’aborder un sujet aussi complexe que sensible.
Vous pouvez retrouver le site dédié à la Charte: lien





L’actualité SINGA
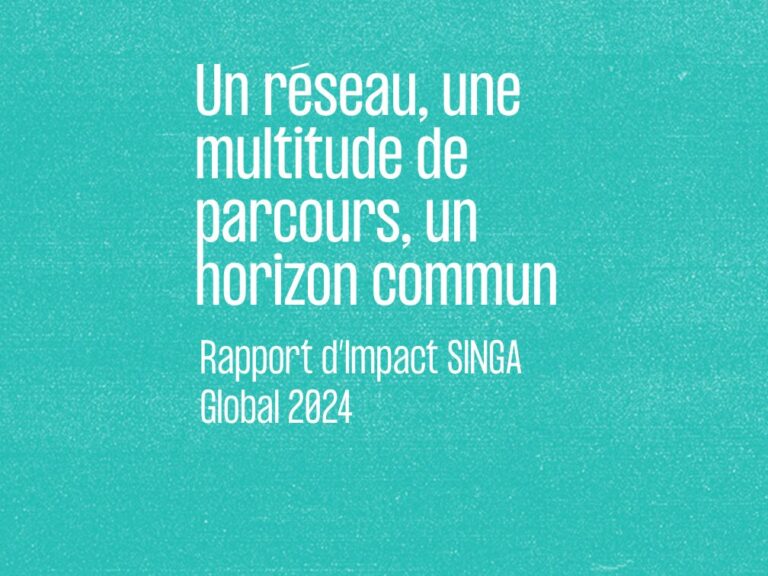
Mesurer l’inclusion sans la réduire : SINGA publie son premier rapport d’impact

Entreprendre avec SINGA en 2026 : les appels à candidatures sont ouverts partout en France
