- À Propos
- SINGA dans le monde
- Entrepreneuriat
- Rencontres interculturelles
- Se former et s’informer
SINGA Bruxelles franchit le cap des 200 cohabitations solidaires : bilan et perspectives

Depuis 2019, plus de 200 cohabitations solidaires ont vu le jour avec SINGA Bruxelles. Des colocations pas tout à fait comme les autres. Des foyers où se rencontrent des personnes réfugiées en quête de logement et des habitant·es locaux·ales désireux·ses de faire de l’accueil une réalité. Un pari humain, porté par le programme Cohabitations Solidaires de SINGA Bruxelles, qui repose sur une idée simple : vivre ensemble, vraiment. Et ça fonctionne.
Trouver un toit, mais aussi une place
À Bruxelles, la crise du logement frappe durement les personnes exilées. Pas faute de motivation ou de moyens : ce sont les loyers trop élevés, le manque d’offres, et surtout les préjugés qui ferment les portes. C’est là qu’intervient SINGA.
Depuis six ans, SINGA Bruxelles met en relation des personnes reconnues réfugiées avec des Bruxellois·es qui disposent d’une chambre libre. Deux formules cohabitent dans le programme : la colocation solidaire de long terme, et la cohabitation dite « de transit », plus temporaire et souvent plus familiale. Dans les deux cas, tout repose sur une équation à la fois délicate et puissante : l’égalité, la confiance, et un accompagnement bienveillant.
Chaque cohabitation débute par un « matching » soigneusement préparé. Les profils sont analysés avec attention : langues parlées, rythme de vie, affinités, attentes. Le but n’est pas de forcer une rencontre, mais de créer les conditions d’un équilibre. Ensuite, un·e adminbuddy — volontaire formé·e — accompagne la personne réfugiée dans ses démarches administratives, et l’équipe SINGA assure un suivi continu. Rien n’est laissé au hasard. Tout est pensé pour que l’expérience soit fluide, respectueuse, et enrichissante.
« La maison est devenue une grande famille »
Marina, arrivée seule à Bruxelles il y a deux ans, se souvient de son premier soir dans sa cohabitation solidaire. Elle ne connaissait personne, parlait peu le français. Puis il y a eu les premiers repas, les conversations, les fous rires. « On partage tout : les tâches, les dîners, les projets. J’apprends la langue, je comprends mieux la ville. Je me sens enfin chez moi. »
Comme elle, plus de 140 personnes réfugiées ont témoigné dans le cadre de l’enquête menée par SINGA Bruxelles entre 2019 et 2024. Les résultats sont sans appel : 95 % d’entre elles se disent satisfaites ou très satisfaites de l’expérience. Et, surtout, 93 % estiment que cette cohabitation a renforcé leur sentiment d’intégration en Belgique.
Au-delà de l’hospitalité, c’est un changement de perspective qui s’opère. Pour les personnes exilées, vivre avec des locaux permet de découvrir les usages, de nouer des liens, de reprendre pied. Mais aussi d’avancer. Après six mois de cohabitation, le taux d’accès à l’emploi ou aux études augmente significativement : plus de 30 % des participant·es ont trouvé un travail ou repris une formation, contre moins de 20 % avant leur installation.
Des rencontres qui transforment des deux côtés
Les personnes locales ne sont pas en reste. 83 % d’entre elles se disent satisfaites de leur expérience. Et pour beaucoup, c’est même une révélation. Coraline, colocataire dans le centre-ville, raconte : « Ce n’est pas différent d’une autre colocation, sauf que l’échange est plus riche. On parle de choses qu’on n’aborderait jamais ailleurs. On apprend à écouter, à se décoder. Et à vivre avec d’autres repères. »
Loin des clichés, ces cohabitations montrent que les différences culturelles ne sont pas des obstacles, mais des déclencheurs de lien. Repas partagés, fêtes, discussions sur la politique, la famille ou la religion… autant d’occasions d’ouvrir le dialogue et de déconstruire les idées reçues.
Les adminbuddies, ces bénévoles de l’ombre, jouent un rôle clé dans cette dynamique. Ils accompagnent les personnes réfugiées dans les méandres administratifs belges, mais bien souvent, ils tissent aussi une relation d’amitié. « J’ai fêté avec lui son premier contrat de travail, se souvient Laura. Il m’a offert une visite de brasserie pour me remercier. C’est moi qui suis ressortie grandie de cette expérience. »
Une solution inclusive qui mérite d’être soutenue
Avec plus de 200 cohabitations formées en six ans, SINGA Bruxelles a prouvé que ce modèle fonctionne. Il est efficace, humain, souple, et adapté à une société de plus en plus diverse. Mais son développement reste entravé par des obstacles administratifs et juridiques.
Le principal frein : la domiciliation. En Belgique, accueillir quelqu’un chez soi peut modifier la composition du ménage et affecter les droits sociaux de l’hôte. Pour les personnes réfugiées, le « taux cohabitant » réduit parfois drastiquement leurs allocations. Ces règles, pensées pour d’autres contextes, pénalisent injustement les projets solidaires.
Pourtant, des solutions existent. En Flandre, un dispositif permet depuis 2016 la domiciliation sans impact fiscal. La jurisprudence rappelle que le taux cohabitant ne peut s’appliquer automatiquement. À Bruxelles, il suffirait de quelques ajustements pour débloquer un formidable levier d’inclusion.
L’ambition de SINGA Bruxelles est claire : accompagner jusqu’à 80 cohabitations par an. Le besoin est là. La société est prête. Il ne manque qu’un soutien politique et structurel pour passer à l’échelle.



Partager son chez-soi, c’est créer du chez-nous. Rejoignez l’aventure !
Ce que l’enquête révèle au fond, ce n’est pas seulement un projet efficace. C’est une philosophie de l’accueil. Une manière de faire société autrement. Cohabiter, ce n’est pas tout partager, mais c’est choisir de ne pas vivre côte à côte en ignorant l’autre. C’est accepter d’ouvrir sa porte, et parfois, son cœur.
Comme le dit l’un des participants : « J’ai découvert une autre culture, mais surtout, j’ai découvert une autre manière d’être au monde. »
Et si c’était ça, le vrai chez-nous ?
👉 Découvrir le programme de Cohabitations Solidaires et les activités de SINGA Bruxelles : lien
L’actualité SINGA
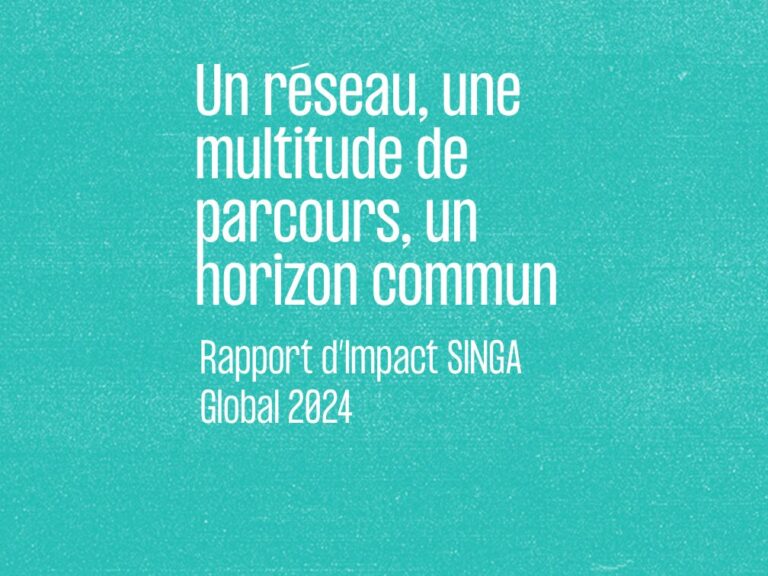
Mesurer l’inclusion sans la réduire : SINGA publie son premier rapport d’impact

Entreprendre avec SINGA en 2026 : les appels à candidatures sont ouverts partout en France
